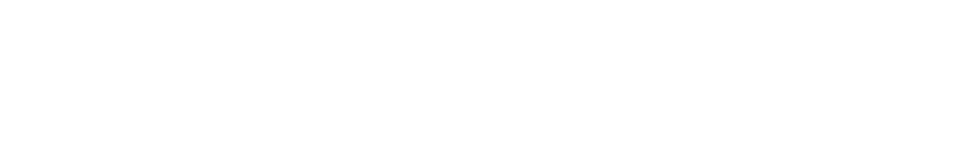- Accueil
- Comptes-Rendus
- Un siècle de sceaux figurés (1135-1235)
- Dictionnaire du blason
- Armorial d’Haïti
- Sceau médiéval
- Les armoriaux médiévaux
- Armorial de la Toison d’or
- Catalogue des sceaux médiévaux des Archives de la Haute-Savoie
- De l’un en l’autre
- Chartrier de Nivernai
- Gothic
- Sceaux médiévaux d’Eure-et-Loir
- Revel
- Le Breton
- Napoléon
- La maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit
- Il valore des simbolo
- L’armorial de Calliope
- Armorial des communes de l’Algérie française
- Les sceaux des princes territoriaux belges, de 1482 à 1794
- Les échevins de Bruxelles
- Inventaire des collections de matrices de sceaux des Archives générales du royaume et de la Bibliothèque royale
- Empreintes du passé
- Medieval Coins and Seals. Constructing Identity, Signifying Power
- Seals and their context in the Middle Ages
- Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux
- Actes de colloques
- Actualités
- Abonnement
- Test
- Multimédia
- Revue
- Tome n° 76 (2006)
- Tomes n° 73-75 (2003-2005)
- Tomes n° 71-72 (2001-2002)
- Tomes n° 69-70 (1999-2000)
- Tomes n° 67-68 (1997-1998)
- Tome n° 66 (1996)
- Tome n° 65 (1995)
- Tome n° 64 (1994)
- Tomes n° 62-63 (1992-1993)
- Tomes n° 60-61 (1990-1991)
- Tomes n° 54-59 (1984-1989)
- Tomes n° 51-53 (1981-1983)
- Tome n° 50 (1980)
- Tomes n°36-49 (1970-1979)
- Tomes n° 27-35 (1960-1969)
- Tomes n° 1-26 (1947-1958)
- Tome n°77-79 (2007-2009)
- Tomes n°80-82 (2010-2012)
- Première série : tomes 1 et 2 (1938-1939)
- Tomes n° 83-85 (2013-2015)
- Tome n° 86. Matrices de sceaux
- Tomes 90-91. Sceaux français de l’ordre de Prémontré
- Tome n°87-89 (2017-2019)
- Tome n° 92 (2022)
- Tome 93 (2023)
- Veille documentaire
- Matrice de sceau de la cour de l’archidiacre de Langres (XIVe-XVe siècle)
- Matrice de sceau de Guichard de Casteio (XVe siècle)
- Matrice de sceau de Jacques, curé de Saint-Martin de ? (fin XIIIe-déb. XIVe s.)
- Matrice de sceau de Jacques Esmere, clerc (XIIIe-XIVe siècle)
- Médaille de Yves Metman
- Matrice d’Etienne le Tonnelier (XIVe siècle)
- Matrice de sceau non identifiée (XIIIe-XIVe siècle)
- Sceau de Madeleine de Neipperg (XVe-XVIe siècle)
- Sceau de Bon-Joseph Dacier (1790)
- In Memoriam
- Bibliographies
- Colloques et conférences
- Héraldique
- Conférences de l’année 2022
- Conférences de l’année 2023
- Sigillographie
- Éditions en ligne
- Travaux universitaires
- Vidéos
- Multimédia
- Comptes-Rendus
- Présentation
- Adhésion
- Liens
- Contact
- Mentions légales
Comptes rendus de lecture
Gothic. Art for England 1400-1547, [Catalogue d’exposition, Londres, Victoria and Albert Museum, 2003], dir. Richard MARKS et Paul WILLIAMSON, assistés d’Eleanor TOWNSEND, London, V&A Publications, 2003, 25,5×29,9 cm cm, 496 p., ill. couleur.
L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364-1419) [Catalogue d’exposition, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 28 mai-15 septembre 2004, et Cleveland Museum of Art, 24 octobre 2004-9 janvier 2005], Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 22×28 cm, 2004, 368 p., ill. couleur.
Paris, 1400 : les arts sous Charles VI [Catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, 22 mars-12 juillet 2004], dir. Elisabeth TABURET-DELAHAYE, avec la contribution de François AVRIL, Paris, Fayard-Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2004, 22×28 cm, 416 p., ill. couleur.
Une fondation disparue de Jean de France, duc de Berry : La Sainte-Chapelle de Bourges [Catalogue d’exposition, Bourges, Musée du Berry, 26 juin 2004-31 octobre 2004], dir. Béatrice de CHANCEL-BARDELOT, Paris-Bourges, Somogy – Musée du Berry, 2004, 26×28,5 cm, 223 p., ill. couleur.
On se souviendra du début des années 2000 comme de l’époque d’un véritable engouement pour le Moyen Âge : il y aura eu en 2004, les expositions de Paris, de Bourges, Dijon et Chantilly consacrées à l’art sous le règne de Charles VI, décryptant de manière tout à fait passionnante la création artistique sous le patronage des grands mécènes que furent les princes Valois ; il y eut aussi en 2005 la grande exposition L’Art Roman au Louvre qui révéla au grand public les admirables chefs d’œuvres du tournant du XIe siècle ; il y eut enfin, au titre des grandes expositions internationales, Gothic. Art for England 1400-1547, qui, quelques deux ans avant les expositions françaises, explora de manière tout à fait intéressante l’art et la civilisation anglais d’une époque particulièrement bousculée et riche.
Laissons à regret l’art roman, les œuvres que nous offre le catalogue se prêtant assez mal au questionnement qui nous occupe ici, pour en arriver à la charnière historique que constitue le règne de Charles VI.
Il y a quelques années, une exposition explorant la production de la manufacture de Sèvres sous le règne de madame de Pompadour s’était ironiquement intitulée Un défi au goût. Il fallait bien entendu comprendre au bon goût, tant les formes contrariées du Rocaille et les prouesses techniques dont la manufacture avait fait preuve alors, pouvaient heurter notre sensibilité contaminée par le goût du zen. Que ceux qui aiment l’austérité supposée de l’art roman me pardonnent, les trois expositions dont je vais rendre compte remettent sans doute en cause une certaine conception de l’art médiéval que l’on réduit trop souvent à ses formes les plus dépouillées. Non, à l’instar des membres de la haute société de la première moitié du XVIIIe siècle, les princes de la fin du Moyen Âge adorèrent les formes complexes, les contrastes chromatiques osés, l’or, les gemmes, les perles, l’émaillerie aux couleurs vives, en fait tout ce qui brille. Ils aimèrent vivre dans des intérieurs couverts de lourdes tapisseries, aux présentoirs chargés de riches pièces d’orfèvrerie, aux tables ornées de fontaines à vin musicales. Bref un monde pour lequel le luxe est un élément essentiel du décor et le décor un élément essentiel de l’art de gouverner.
Toute l’exposition tournait autour des deux admirables monuments d’orfèvrerie que le Louvre eut le privilège d’accueillir : le Goldens Rössl d’Altötting (cat. 95) et le reliquaire de Montalto (cat. 99). Même si l’on peut pencher pour la charge dramatique et le doloriste du second, le « Cheval d’or », qui est considéré comme un des monuments essentiels de l’histoire de l’orfèvrerie, doit aussi interpeller ceux qui s’intéressent à la représentation du pouvoir et à l’emblématique royale. Pour quelle action de grâce Isabeau de Bavière offrit à son royal époux un tel monument où le roi est représenté en prière devant une Vierge à l’enfant sous une treille émaillée, la tête simplement ceinte d’un tortil ? Voilà une image de la royauté loin de la majesté trônant à laquelle nous sommes habitués. Le manteau royal fleurdelisé et la discrète couronne du casque sont là néanmoins pour nous rappeler que l’orant est roi.
Une des réussites formelles fondamentales de l’emblématique royale, assavoir le semé de fleurs de lis, demeure un motif omniprésent s’adaptant à merveille au décor textile dont il ne reste presque plus rien sauf bien évidemment dans les peintures contenues dans les livres.
Nous en arrivons là au second point fort de cette exposition où François Avril nous a offert une impressionnante série de livres enluminés dont les richesses à peine entrevues, mais c’est là une des règles de conservation avec laquelle on ne peut transiger, sont nécessairement mal desservies, malgré le talent et l’érudition de l’auteur, par les courtes notices du catalogue qui traitent des livres dans leur entièreté et non pas précisément des enluminures figurant dans le catalogue. Profitons de ces quelques lignes pour affirmer la nécessité des publications in extenso de tels trésors.
Plus que tout autre art, les livres peints ont conservé les couleurs dans leur fraîcheur originale ; ils sont aussi des répertoires de l’emblématique du temps. Jean de Berry, le plus grand bibliophile de son époque, commanda des chefs d’œuvres incomparables, citons ses Grandes Heures (cat. 43), ou bien encore ses Heures de Bruxelles (cat. 45). Au folio 37 des premières, la page est encadrée par une bordure de feuillages ornée de quadrilobes à redents semblables à ceux que l’on trouve sur les sceaux et dans lesquels alternent les armes ducales, des cygnes, et des ours tenant des bannières. Mais c’est n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres.
L’omniprésence du portrait est un axe qui n’a pas été retenu dans le catalogue mais qui peut apparaître comme son fil rouge. Il s’agit non seulement du portrait individuel, donnée incontournable de l’art curial de ce Moyen Âge finissant, mais la notion peut être extrapolée à l’ensemble du système de représentation réel et symbolique. Les peintres s’attachent alors à rendre de manière objective le physique et ses disgrâces, les bâtiments et leurs intérieurs mais aussi de manière précise et documentée les éléments de la nature.
Grâce aux Très riches heures de Jean de Berry, exposées alors à Chantilly, nous avons une connaissance précise des grands monuments disparus ou drastiquement transformés. Le Louvre, Vincennes, Mehun-sur-Yèvre et tant d’autres joyaux – dont l’exposition présente d’ailleurs des fragments de décor sculpté – apparaissent avec une précision de géomètre et un art consommé de l’anecdote.
Citons les deux fameuses enluminures tirées respectivement des Dialogues de Pierre Salmon et des Œuvres de Christine de Pisan (cat. 52 et 55) qui nous donnent des représentations précises des chambres de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, non seulement de leur mobilier, de la place que pouvaient occuper les proches des souverains, mais surtout de la somptuosité du décor et notamment du décor textile. Dans la chambre de la reine, l’alternance des panneaux de tissus semés de fleurs de lis avec ceux ornés du losangé de Bavière, exprime parfaitement la force graphique et symbolique de l’un et le caractère presque essentiellement décoratif du second. Mais, à bien observer ces images on peut y voir la moindre passementerie, le moindre carreau, tous les détails des vêtements sans jamais que l’œil ne se perde dans le détail. Des œuvres à la fois détaillées et synthétiques, n’est ce pas là les qualités premières du portrait ?
Mais le portrait c’est aussi l’emblématique. Face à la fixité de l’héraldique qui détermine l’individu dans un groupe et dont on ne peut guère changer, les devises dont ces cours font un usage immodéré l’individualisent. La surabondance de ces éléments dont on change au gré des circonstances, fabrique un discours exprimé dans le cadre de cours concurrentes et mêlées ou le moindre signe fait sens. Que l’on pense à Jean de Berry et ses extraordinaires tenues vestimentaires semées de cygnes, orné de bijoux décorés d’ours, que l’on pense à Jean sans Peur et ses rabots destinés à réduire le bâton noueux des Orléans.
Mais il existe aussi une emblématique plus personnelle que politique qui révèle les traits de la personnalité de ceux qui s’en dotent mais dont la signification profonde nous échappe parfois encore. Que signifient, le cerf volant, le tigre, le paon ou l’hirondelle, les mots ESPERANCE ou JAMES pour Charles VI ?
Sentant sans doute les carences du catalogue sur ce sujet si fondamental pour l’époque, les commissaires de l’exposition ont ajouté en annexe un tableau particulièrement intéressant récapitulant les multiples devises de Charles VI où l’on apprend que le roi n’est pas en reste face à la surabondance emblématique des membres de sa famille. Cette étude qui aurait mérité plus de développement est passionnante et il conviendrait d’élargir ce type d’enquête à tous les grands princes du temps.
Un seul regret cependant : la prouesse d’éditer un catalogue aussi abondamment illustré pour une somme aussi modique a sans doute contraint les responsables à limiter l’espace voué aux textes et notamment aux essais introductifs vraiment trop courts. On regrette par exemple la brièveté de l’essai de Ghislain Brunel sur la diplomatique et la sigillographie.
Si Paris est demeuré jusqu’aux lamentables années de la fin du règne de Charles VI le centre incontesté des arts en Europe, les princes apanagés ont entretenu dans leurs domaines des centres artistiques qui diffusèrent et relayèrent dans l’Europe entière la production artistique française. Jean de Berry fut un collectionneur boulimique, il fut aussi un constructeur, comme en témoigne le joli catalogue consacré à la Sainte-Chapelle de Bourges. Louis d’Orléans fit édifier de nombreux châteaux, prenant en quelque sorte le relais du mécénat défaillant de Charles VI. Mais ce sont les ducs de Bourgogne qui apparaissent sans conteste comme les plus grands mécènes de leur temps.
C’est à Dijon que revint le privilège d’étudier lors d’une belle exposition le mécénat de ces fastueux princes que furent Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Exposition complémentaire à ce qui se faisait alors au Louvre et qui s’attarda à un sujet plus précis sans pour autant en embrasser tous les aspects.
L’abondant matériau exposé à Paris se suffisait à lui même. Les questions qui nous occupent ici étaient traitées en quelques sortes d’elles même. En revanche, même si à Dijon on exposa d’authentiques chefs d’œuvres, même si l’on peut y admirer le Puits de Moise et les tombeaux ducaux, le visiteur pouvait être quelque peu déçu, surtout s’il avait déjà visité l’exposition du Louvre. Mais c’était sans compter sur le catalogue, plus abondant en textes, lui aussi très illustré qui pallia heureusement les effets de cette éventuelle déception. On y aborde des questions plus archéologiques comme les résidences ducales bourguignonnes presque toutes détruites ; on y traite la question des fondations religieuses et bien évidemment de Champmol. Au titre des questions héraldiques, notons le magnifique dossier de chaire aux armes de Jean sans Peur (cat. 61) qui évoque les splendeurs du décor mobilier de cette chartreuse ou l’amusante boite de messager aux armes de Bourgogne (cat. 25), sans oublier les carreaux de pavage (cat. 64) dont les décors oscillant entre héraldique, emblématique et ornement pur sont souvent les seuls éléments rescapés des demeurent ducales.
Avant d’aborder ce que l’on fit à Londres, il nous sera permis d’ajouter que le principe d’expositions simultanées – auxquelles il faut bien évidemment ajouter celle qui eu lieu au château de Chantilly ou l’on vit se tourner les plus belles pages des Très riches heures des frères Limbourg – est une idée que l’on aimerait voir se réaliser plus souvent, idée qui eut le mérite de brosser dans un bel effort synergique le portrait d’un monde à la fois éloigné et proche de nos préoccupations.
Un premier constat s’impose : contrairement aux expositions françaises, les commissaires anglais ont choisi de traiter une période beaucoup plus longue, débordant le cadre chronologique traditionnel séparant le Moyen Âge des temps modernes. Cette barrière qui, dans l’Europe du Nord et en Angleterre en particulier, n’a guère le sens qu’elle peut avoir en Italie, vole en éclat devant un gothique dont le développement prend outre-Manche des formes tout à fait originales et cela très tard dans le XVIe siècle.
Par ailleurs, alors que les expositions françaises entérinent le rôle central des commanditaires durant une période très courte, l’exposition du Victoria and Albert Museum envisage de manière plus large la civilisation du gothique tardif dans ses multiples manifestations : non seulement artistiques et cela sous toutes les formes de l’acception – l’essai consacré à la musique n’a malheureusement pas d’équivalent en France – mais aussi politiques et idéologiques, religieuses, économiques, prenant en somme la voie d’une anthropologie historique « grand public » tout à fait dans la lignée de la belle vulgarisation dont les Britanniques ont le secret.
D’un point de vue éditorial, l’ouvrage reprend le schéma désormais classique des catalogues d’expositions internationales : après une suite de longs essais consacrés aux domaines dont nous venons de dresser une liste non exhaustive, le plan du catalogue a proprement parler est divisé en grands chapitres abordant des questions aussi variées que les commandes royales et privées, l’image de la monarchie, le mécénat des familles Beauchamp et Neville, le monde de la grande marchandise, l’art funéraire, le paysage urbain etc. Chaque partie est abondamment illustrée, mais cette abondance, comme souvent – trop souvent, peut-être – a l’inconvénient de réduire l’espace consacré aux notices et laisse le lecteur parfois sur sa faim. Cela étant la bibliographie relativement fournies ainsi que la présence d’un index, rendent ce beau catalogue tout à fait utile aux chercheurs et aux amateurs.
Pour les questions qui nous intéressent ici au premier chef, un second constat s’impose : si l’usage de l’emblématique est, à l’image de ce qui se produit alors sur le continent, un phénomène de civilisation majeur, aucun essai ne lui est consacré en particulier. La question est seulement abordée assez lâchement d’ailleurs au chapitre explorant les représentations de la personne royale. Mais ce court texte laisse le lecteur d’autant plus frustré que la belle illustration du catalogue ne cesse d’étaler des richesses héraldiques et, dans une moindre mesure, sigillographiques, de premier ordre. Richesses d’autant plus présentes en Angleterre que le pays ne connut pas les vagues iconophobes huguenotes et le vandalisme révolutionnaire qui détruisirent chez nous la quasi totalité de la peinture médiévale et de l’emblématique d’Ancien Régime, du moins de l’emblématique monumentale.
Il convient de noter, à la décharge des commissaires de l’exposition, combien le choix de décrire le vaste panorama d’une civilisation ne permet guère d’aborder les questions aussi précises que le souhaiteraient les spécialistes, notamment ceux d’emblématique. Cela étant, ce phénomène prenant une telle place dans le système de pensée d’un monde aussi politiquement troublé, aurait à l’évidence mérité quelques développements.
Le lecteur attentif repère assez précisément néanmoins combien, après la période des troubles liés aux changements dynastiques et le « flottement emblématique » qui les accompagne, l’arrivée des Tudor correspond au développement de tout un système emblématique très efficace dont la rose et la herse deviennent les éléments principaux. Citons notamment la « cope » d’Henry VII, nous dirions manteau, conservée au Victoria and Albert Museum (cat. 31). Ce véritable monument textile, bordé d’orfrois hagiographiques rapportés, présente un décor de larges rinceaux de rosiers s’épanouissant en roses Tudor, entre les tiges duquel sont brodées trois herses Beaufort couronnées, le tout entouré par les maillons d’un collier aux deux S interrompus par quatre roses et une quatrième herse. Les badges des parents du monarque, Edmond Tudor et Marguerite Beaufort, se combinant à merveille aussi bien aux superbes voûtes nervurées de la King’s College Chapel de Cambridge qu’aux caissons du plafond renaissance du « Wolsey’s Closet » du palais de Hampton Court.
Mais c’est sans conteste à l’ordre de la Jarretière que revient la palme de l’efficacité iconographique. Cet ordre créé en 1348 est le véritable fil rouge emblématique de la période explorée par le catalogue. Il s’agit, à côté des motifs proprement politiques, d’une véritable réussite formelle ; sa forme circulaire se combine à merveille au portrait de sir Thomas Lowel dont il forme le cadre (cat. 9). Citons également la magnifique tapisserie de la Cloisters collection de New York (cat. 154) mêlant sur un fond de mille-fleurs les armes de Lord Dynham inscrites dans une jarretière, supportées par des cerfs, surmontées d’un armet aux riches lambrequins et cimier et entourées de postes de vigie, badge de celui qui fut commandant de la flotte de la Manche et capitaine de Calais. L’ordre de la Jarretière dont on présente sous le numéro l’exemplaire en parfait état de conservation de Maximilien Ier (cat. 81), est également représenté par l’Armorial de l’ordre que nous devons à William Bruges (cat. 80).
Nous pourrions multiplier les exemples, comme ces amusants tenants de bois polychromes en forme d’animaux emblématisant quatre membres de la famille Dacre (cat. 156), ou bien encore cet ensemble de livres peints d’une extraordinaire richesse ; mais nous laissons au lecteur le plaisir de la découverte.
La sigillographie est malheureusement le parent pauvre de cette exposition, non pas qu’elle n’y figure pas – le catalogue propose un petit corpus de matrices tout à fait intéressant – mais, il y manque une étude poussée. Cette absence d’autant plus dommageable lorsque l’on connaît les richesses iconographiques que les cires offrent alors. Il suffit pour bien s’en convaincre d’observer le second grand sceau d’Henry IV (cat. 33 a et ) si différent de ce que l’on fait alors en France, pays dont la sigillographie apparaît d’un étonnante sobriété face à la surabondance de détails qu’offrent les sceaux anglais. Cette surenchère iconographique et emblématique, faisant voisiner sur une face le souverain en majesté placé dans une riche architecture couverte d’écus aux armes à un revers le montrant galopant, en dit sans doute long sur la problématique d’un roi à la légitimité contestable.
Malgré les défauts du genre, le catalogue de l’exposition du Victoria and Albert Museum permet de jeter un éclairage sur un matériau abondant assez méconnu sur le Continent ; il permet en outre de saisir que si l’Europe partage les motifs d’une même civilisation, ses développements outre Manche sont pour le moins singuliers, notamment pour ce qui concerne l’architecture, qui frappe par son inconstatable singularité. Et l’on comprend les raisons pour lesquelles l’Angleterre du XIXe siècle considéra le gothique comme le style national de la monarchie : c’est que, comme le rappelle l’essai d’Alexandrina Buchanan, il n’y eu pas de réelle rupture entre le chevet de l’abbaye de Westminster, le vestibule de la Christ Church d’Oxford dont la voûte gothique fut construite en 1640 et la cage d’escalier en 1805, et le palais de Westminster que Charles Barry rebâtit trois siècle plus tard.
Clément BLANC-RIEHL