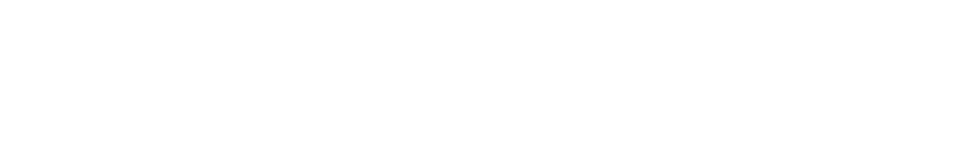- Accueil
- Comptes-Rendus
- Un siècle de sceaux figurés (1135-1235)
- Dictionnaire du blason
- Armorial d’Haïti
- Sceau médiéval
- Les armoriaux médiévaux
- Armorial de la Toison d’or
- Catalogue des sceaux médiévaux des Archives de la Haute-Savoie
- De l’un en l’autre
- Chartrier de Nivernai
- Gothic
- Sceaux médiévaux d’Eure-et-Loir
- Revel
- Le Breton
- Napoléon
- La maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit
- Il valore des simbolo
- L’armorial de Calliope
- Armorial des communes de l’Algérie française
- Les sceaux des princes territoriaux belges, de 1482 à 1794
- Les échevins de Bruxelles
- Inventaire des collections de matrices de sceaux des Archives générales du royaume et de la Bibliothèque royale
- Empreintes du passé
- Medieval Coins and Seals. Constructing Identity, Signifying Power
- Seals and their context in the Middle Ages
- Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux
- Actes de colloques
- Actualités
- Test
- Multimédia
- Revue
- Tome n° 76 (2006)
- Tomes n° 73-75 (2003-2005)
- Tomes n° 71-72 (2001-2002)
- Tomes n° 69-70 (1999-2000)
- Tomes n° 67-68 (1997-1998)
- Tome n° 66 (1996)
- Tome n° 65 (1995)
- Tome n° 64 (1994)
- Tomes n° 62-63 (1992-1993)
- Tomes n° 60-61 (1990-1991)
- Tomes n° 54-59 (1984-1989)
- Tomes n° 51-53 (1981-1983)
- Tome n° 50 (1980)
- Tomes n°36-49 (1970-1979)
- Tomes n° 27-35 (1960-1969)
- Tomes n° 1-26 (1947-1958)
- Tome n°77-79 (2007-2009)
- Tomes n°80-82 (2010-2012)
- Première série : tomes 1 et 2 (1938-1939)
- Tomes n° 83-85 (2013-2015)
- Tome n° 86. Matrices de sceaux
- Tomes 90-91. Sceaux français de l’ordre de Prémontré
- Tome n°87-89 (2017-2019)
- Tome n° 92 (2022)
- Tome 93 (2023)
- Veille documentaire
- Matrice de sceau de la cour de l’archidiacre de Langres (XIVe-XVe siècle)
- Matrice de sceau de Guichard de Casteio (XVe siècle)
- Matrice de sceau de Jacques, curé de Saint-Martin de ? (fin XIIIe-déb. XIVe s.)
- Matrice de sceau de Jacques Esmere, clerc (XIIIe-XIVe siècle)
- Médaille de Yves Metman
- Matrice d’Etienne le Tonnelier (XIVe siècle)
- Matrice de sceau non identifiée (XIIIe-XIVe siècle)
- Sceau de Madeleine de Neipperg (XVe-XVIe siècle)
- Sceau de Bon-Joseph Dacier (1790)
- In Memoriam
- Bibliographies
- Conférences de l’année 2025
- Conférences de l’année 2024
- Colloques et conférences
- Héraldique
- Conférences de l’année 2022
- Conférences de l’année 2023
- Sigillographie
- Éditions en ligne
- Travaux universitaires
- Vidéos
- Multimédia
- Comptes-Rendus
- Présentation
- Adhésion
- Liens
- Contact
- Mentions légales
Comptes rendus de lecture
Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux, Xe-XVIe siècle
Marc LIBERT et Jean-François NIEUS (éd.), Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux, Xe-XVIe siècle. Entre contrainte sociale et affirmation de soi. Actes du colloque de Bruxelles et Namur, 27-28 novembre 2014, Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, numéro spécial 103, 2017, 336 p. + ill. noir et blanc, et couleur. ISSN : 0775-0722. Prix : 25 € (hors TVA) reliure souple.
A l’occasion du 150e anniversaire de la collection de 38.000 moulages de sceaux des Archives générales du Royaume de Belgique, réalisée à partir de 1864 par Alexandre Pichart, conservée à Bruxelles et en mise en ligne en 2014, un colloque s’est tenu à Bruxelles et Namur les 27 et 28 novembre 2014, organisé par les AGR et l’Université de Namur. Les actes en ont été publiés en 2017, sous la direction de Marc Libert (Université libre de Bruxelles-AGR) et Jean-François Nieus (Université de Namur). L’ouvrage se concentre sur l’espace belge, appelé Pays-Bas méridionaux, avec des excursions en Angleterre, en Italie, dans le Nord de la France et dans les terres rhénanes. Les contributions abordent dans un premier temps les questions de conservation, archivage, restauration, mise en ligne – bref, préservation et communication de la source –, évoquées lors de la première journée du colloque à Bruxelles. Elles développent dans un second temps les analyses thématiques d’historiens et historiens de l’art présentées à Namur lors de la seconde journée.
John Cherry (British Museum) présente des sur-moulages en métal d’époque moderne effectués sur des matrices ou des empreintes de sceaux médiévales et modernes. Ces « moulages de métal » sont des vestiges précieux de sceaux dont beaucoup ont aujourd’hui disparu. Ces objets soulèvent également nombre de questions sur leur raison d’être : modèles soumis au client ou souvenirs de travaux de prestige, commandes de collectionneurs ou objets de professionnels se constituant de véritables catalogues destinés à faciliter leur travail… Cet article aborde en particulier les moulages du collectionneur anglais Sloane, aujourd’hui au British Museum, et ceux de son contemporain, l’italien Lorenzani, un artisan produisant ce type d’œuvre. Il donne un coup de projecteur sur ces objets méconnus, mal repérés dans les collections des musées, longtemps négligés, mais qui ont toute leur place dans des études de sigillographie, notamment comme source indirecte pour des sceaux disparus.
Marie-Adélaïde Nielen (Archives nationales) présente l’état de la recherche autour de la question des fibres prises dans les galettes de cire des rois mérovingiens et carolingiens. Ce sujet, souvent évoqué dans les ouvrages de sigillographie, fait l’objet depuis quelques années d’une recherche exhaustive de la part d’une équipe dirigée par l’auteur, étude à la fois diplomatique, biologique, chimique et radiographique, basée sur un corpus de 300 actes royaux antérieurs à 987, dont une cinquantaine encore scellés – 7 seulement d’époque mérovingienne –. Un peu plus d’une vingtaine d’empreintes comportent des poils ou cheveux. Cet article détaille l’état de conservation du corpus : à la fois valorisé du fait de son ancienneté par l’aménagement de meubles spécifiques dans les Grands dépôts des Archives nationales, et délaissé au fil du temps non par désintérêt mais par crainte respectueuse pour ces actes, ancêtres parmi les ancêtres. Surtout, le travail de restauration est immense : les solutions d’antan visant à protéger ces honorables vestiges se révèlent parfois désastreuses. Les divers questionnements auxquels sont confrontés les archivistes sont détaillés : inventoriage rigoureux, restauration, conditionnement, rangement, communication (physique ou numérique). Cette contribution met en lumière le caractère pluridisciplinaire d’un tel projet : archivistes, restaurateurs de sceaux, de parchemin et de papyrus, médecins, chimistes, photographes, menuisiers… L’analyse chimique des cires révèle que, malgré les variations radicales de teintes (du jaune au brun), il s’agit systématiquement de cire d’abeille vierge, sans colorant. Les fibres prises dans ces cires sont des cheveux ou poils humains, en quantité notable – touffes, et non cheveu isolé – dont l’usage décline brutalement après Louis le Pieux. Les esprits facétieux retiendront que le règne de Charles le Chauve semble marquer la fin de cet usage. Les analyses ADN confirment qu’il s’agit de cheveux humains et masculins mais ne peuvent déterminer de lien de parenté, même si l’auteur estime qu’il ne s’agit pas des cheveux de quelques chanceliers mais bien ceux des monarques. Certains sceaux contiennent des poils animaux, mais il pourrait s’agir de copies postérieures, ainsi que des fibres végétales. L’analyse poussée de ces actes devrait aider à la compréhension des modes de scellement, voire de re-scellement ou de falsifications. Enfin, Marie-Adélaïde Nielen conclut son article en faisant un point bienvenu sur les sceaux royaux de l’époque mérovingienne.
Agnès Prévost (Archives nationales), qui participe au projet précédent, livre quant à elle une réflexion sur les pratiques de l’atelier de restauration des sceaux des Archives nationales depuis sa fondation officielle en 1857. Elle rappelle en particulier que, loin de se limiter à la production de moulages – pour certains essentiels car les originaux ont aujourd’hui disparu –, l’atelier travaille au plus près des originaux. Après avoir décrit les différentes méthodes de moulage utilisées par l’atelier, l’auteur souligne les spécificités de conservation et de restauration des actes scellés qui mêlent support en parchemin, empreinte de cire, attaches en divers matériaux. L’atelier des Archives nationales fut pionnier, expérimentant – parfois avec maladresse –, validant ou renonçant à certaines techniques, formant des personnels venus des départements français ou de l’étranger. Cet article montre qu’il reste à la pointe dans la recherche des meilleures techniques de restauration, malgré la réduction dramatique de ses moyens humains qui fait peser le risque de perte du savoir-faire patiemment élaboré au fil du temps. L’outil informatique – une base de donnée des sceaux restaurés – a conduit à formaliser le vocabulaire employé pour décrire l’état initial du sceau puis les étapes de restauration : en effet, certaines descriptions anciennes de restauration étaient sources d’interrogation pour les restaurateurs actuels. Agnès Prévost insiste finalement dans cet article sur les similitudes entre la démarche de restauration des sceaux et celles employées pour d’autres vestiges anciens (objets, meubles ou monuments). Si les sceaux ont une histoire, elle nous rappelle que leurs techniques de restauration également.
La contribution d’Ekaterina Nosova (Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences de Russie) vient illustrer à propos l’importance des échanges entre chercheurs étrangers et services d’archives, notamment français et belges dont les pratiques de conservation et les ateliers de moulage servaient de modèles à la fin du XIXe siècle. L’auteur présente ici la collection de moulages de sceaux de Nicolai Likhatchev, père de la diplomatique russe. Celle-ci fut constituée à partir d’exemplaires commandés auprès des Archives nationales mais aussi achetés en Allemagne. Toute l’originalité de cet article tient en la spécificité de cette collection : elle était destinée à être un outil de travail pour l’universitaire collectionneur. Il ne s’agissait donc pas d’une accumulation résultant du hasard des trouvailles mais d’achats raisonnés répondant à des objectifs pédagogiques. Cette collection est aujourd’hui encore utilisée pour la formation des étudiants russes.
Autre exemple d’émulation, le projet présenté par Thérèse de Hemptinne et Lieve De Mey (Université de Gand), dont l’ambition est de recenser, à l’image du Corpus des sceaux de Ville de Brigitte Bedos pour la France, l’ensemble des sceaux urbains du comté de Flandre qui couvre Zélande, Flandres et Hainaut belge, et nord de la France. 62 sceaux seront ainsi présentés dans un répertoire bilingue et illustré unique, alors que nombre d’entre eux se trouvaient jusqu’à présent mentionnés dans divers ouvrages. Ce travail est loin d’être une simple compilation : la consultation d’originaux, même fragmentaires, a permis de lister plusieurs dizaines de sceaux jusqu’alors inconnus, ou confondus avec d’autres types ; les descriptions dans des ouvrages modernes, les mentions dans les octrois et les annonces de sceaux affinent les fourchettes chronologiques d’utilisation des sceaux. Comme il est maintenant l’usage, les contre-sceaux sont destinés à être recensés à part du sceau qu’ils complètent. Cires et modes d’attaches des divers exemplaires seront relevés. Une fiche modèle est présentée, donnant un aperçu du travail final. Cet article montre une fois de plus l’importance de revenir aux sources, à ces documents originaux qui nous semblent parfois connus mais dont la consultation affine les connaissances, voire permet de corriger des erreurs de lecture ou d’interprétation. Après avoir présenté ce projet ambitieux, l’article offre un rapide panorama des usages sigillaires de ces villes du comté de Flandre depuis 1200.
Marc Libert (Université libre de Bruxelles, AGR), qui a présenté la numérisation des collections de moulages de sceaux des AGR lors du colloque de Lille en 2008, aborde ici les perspectives offertes par la numérisation en 3D des matrices conservées par cette même institution. Cet article est l’occasion pour l’auteur de présenter l’historique de cette collection, inventoriée en grande partie il y a une vingtaine d’années par René Laurent et Claude Roelandt. Riche de plus de 2.000 pièces, elle compte une majorité de matrices d’époque moderne et contemporaine. Plus d’un quart ne sont pas datées, et on compte une quarantaine de faux. L’essentiel de cette collection provient du versement des collections de la Bibliothèque royale de Belgique et des Musées royaux d’Art et d’Histoire. Les achats par les AGR furent rares, ce que regrette l’auteur qui précise néanmoins que l’institution, consacrée à la conservation d’archives publiques, dispose de faibles budgets pour les acquisitions. L’histoire des collections de la BR et des MRAH est difficile à établir, de même que les acquisitions des AGR : les mentions d’achats, donations, dépôts et legs font souvent défaut, ou leurs circonstances demeurent floues, les inventaires manquent. La collaboration entre institutions fut largement dépendante des bonnes – ou mauvaises – volontés des conservateurs et archivistes, ou plus simplement de leur degré d’intérêt ou de compétence en matière de sigillographie. Cet article démontre que les personnalités des femmes et hommes à l’œuvre comptent souvent plus dans l’avancement ou l’obstruction d’un projet que le poids des institutions qui accordent les financements. La valorisation des collections sigillographiques des AGR depuis une vingtaine d’années a conduit au projet de numérisation en 3D des matrices en collaboration avec les MRAH. Comme pour les moulages, ce projet a pour ambition de mettre en ligne, à disposition du public, des images en volume des matrices de sceaux. Le traitement informatique des photographies nécessitera quatre à cinq ans de travail. Il s’accompagne d’un travail de restauration et de nettoyage des matrices, d’inventoriage, puis de leur reconditionnement pour archivage. C’est donc un projet global et pluridisciplinaire qui est ici présenté.
Dernier chapitre consacré aux questions de préservation et communication de la source sigillaire, la contribution de Laurent Hablot (EPHE) présente le projet SIGILLA, désormais consultable en ligne (www.sigilla.org). L’auteur rappelle les origines du projet, né du rapprochement des Archives départementales de la Vienne, désireuses de valoriser leurs fonds sigillographiques, avec l’Université de Poitiers, notamment le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM). Ce fut l’occasion pour les équipes concernées de constater que nombre d’initiatives départementales existent mais sans coordination ni compatibilité des systèmes informatiques. Face à cette mosaïque de projets est née l’idée d’élaborer une base de données nationale avec l’aide de plusieurs laboratoires, archives, musées, sociétés savantes et informaticiens, à l’image de ce qui existe au Portugal, en Allemagne, au Pays de Galles ou avec le projet international SIGILLVM. Le projet SIGILLA est destiné à mettre à disposition du public un corpus de sceaux conservés en France. La description est basée sur le prototype initial du sceau, c’est à dire la matrice si elle est connue ou une reconstitution s’appuyant sur les différentes empreintes connues. Sont intégrés à la fois des sceaux déjà inventoriés dans les catalogues (Douët d’Arcq, Demay, Coulon…) et des sceaux inédits. Surtout, chaque notice est illustrée. Ce travail en cours est destiné à s’enrichir au fil du temps. Il compte à ce jour près de 4800 sigillants pour 7200 empreintes (consulté le 23/02/2019).
Jean-François Nieus (Université de Namur) ouvre la série des chapitres consacrés aux études de cas avec une remarquable présentation de la question des sceaux équestres dans l’Empire. Après avoir rappelé les spécificités germaniques (un sceau équestre réservé aux aristocrates ayant au moins rang comtal, et une bannière exclusivement princière), l’auteur s’attache à exposer les preuves les plus anciennes de l’usage du type équestre en terre d’Empire. Son travail fut facilité par la mise en ligne de banques de données consacrées aux plus anciennes chartes conservées dans divers fonds allemands, belges, français. En revanche, la période offre nombre d’actes et de sceaux faux ou douteux, ou longtemps réputés tels mais aujourd’hui réhabilités pour certains. L’auteur rappelle l’influence occidentale dans l’adoption du sceau par certaines familles germaniques dès le milieu du XIe siècle, mais également l’influence italienne qu’il juge trop négligée jusque-là. Le type équestre, né en Angleterre sur le sceau double de Guillaume le Conquérant, arrive dans l’Empire par le biais du comte de Flandre Robert Ier le Frison qui a imité l’Anglo-normand dès le début des années 1170 : ses proches parents et rivaux, Baudouin II de Hainaut et Henri de Louvain, s’emparent du motif vers 1180. Flandre et Lotharingie constituent le centre de diffusion du sceau équestre dans l’Empire dans un mouvement d’Ouest en Est. L’ensemble des ducs et marquis, à deux exceptions près, adoptent le sceau équestre dans la première moitié du XIIe siècle, presque tous porteurs de la lance à la bannière et du bouclier. Si l’essentiel des comtes d’Empire s’emparent du sceau équestre seulement après 1150, hésitant entre lance et épée, les lisières flamande et lotharingienne offrent des cas antérieurs, y compris parmi les simples seigneurs. Cet article fouillé et détaillé fait un point bienvenu sur les influences entre lignages tant pour l’adoption du sceau équestre que pour le style des graveurs dont le travail est parfois imité. Enfin, un tableau récapitulatif en annexe présente les plus anciens sceaux équestres par lignages depuis Baudouin II de Hainaut en 1080.
Les sceaux des seigneurs du Cambrésis sont analysés par Nicolas Ruffini-Ronzani (Université de Namur) jusqu’en 1230. Ce chapitre complète le précédent en s’attachant à un territoire précis de l’Empire. Les usages des châtelains de Cambrai, les sires d’Oisy, sont abordés dans un premier temps, puis est analysée la diffusion du sceau équestre dans les autres lignages notables du Cambrésis, enfin l’émergence du sceau héraldique dans les familles de moins haut rang est précisée. L’adoption d’un sceau par Hugues II d’Oisy en 1135 inaugure le mouvement de diffusion du sceau nobiliaire dans la région. Son petit-fils Hugues III ira jusqu’à posséder trois matrices de grand sceau et un contre-sceau entre 1170 et 1185. L’auteur souligne l’amélioration de la qualité de gravure des matrices successives, sans évoquer toutefois l’aspect technique de la question (progrès de l’art de la gravure en cette fin de XIIe siècle, recours probable à un artisan renommé – peut-être au service des comtes de Champagne auxquels Hugues III est apparenté). La diffusion du sceau équestre concerne dans la seconde moitié du XIIe siècle les domini du Cambrésis, la plupart assumant des fonctions à la cour épiscopale de Cambrai ou auprès des comtes de Flandre et du Hainaut. Nicolas Ruffini-Ronzani rappelle que cette fréquentation a placé ces seigneurs de second rang au contact avec les écrits scellés : ils figurent souvent comme souscripteurs des actes épiscopaux ou comtaux et assistent aux opérations de scellage. En revanche l’adoption des armoiries semble assez lente sur ces sceaux équestres. Elle coïncide en fait avec l’apparition des sceaux héraldiques dans la petite noblesse à partir de 1190. Un tableau récapitulatif vient là encore compléter le propos, indiquant les premières mentions de sceaux en complément des premiers sceaux effectivement conservés.
Dans l’optique d’utiliser les actes pour cerner l’émergence de l’usage du sceau, Benoît-Michel Tock (Université de Strasbourg) aborde la question de l’emprunt de sceau dans le nord de la France aux XIIe et XIIIe siècles. Il a travaillé uniquement à partir des annonces de sceau, démarche qui se révèle très fructueuse. Là encore, la mise en ligne de bases de données permet au chercheur d’interroger un fond à partir de mots-clefs. Ici, l’auteur a exploité la base de données de texte diplomatiques Chartae Galliae à partir des termes sigillum, proprium, habere. Des éditions papier de textes ont été également utilisées. A l’issue de ce travail, deux cas se dessinent : un sigillant fait appel à un second, voire un troisième sceau afin de renforcer le poids du sien ; l’auteur de l’acte ne possède pas de sceau ou ne le porte pas avec lui au moment du scellage et doit donc recourir au sceau d’un autre. Cette dernière situation est rare : 37 cas recensés pour cette étude, à rapporter aux 9.000 chartes que compte la seule base de données Chartae Galliae. Il s’agit toujours de petits seigneurs ou bourgeois –prélats et princes étant alors dotés de sceaux – qui s’adressent à l’évêque, plus rarement aux comtes, mais aussi aux communautés religieuses, à un membre de la famille voire à une ville, Péronne. L’auteur prend soin de fournir nombre d’exemples et de citer en note chaque annonce de sceau. Il remarque que le phénomène touche aussi les notices et les chirographes, ainsi que les actes ayant plusieurs auteurs dont un seul dépourvu de sceau, bien que ces types de production semblent a priori peu propices à ces annonces d’emprunt de sceau. Ce dossier démontre tout l’intérêt des annonces de sceau pour qui souhaite comprendre les usages sigillaires.
Clément Blanc-Riehl (Archives nationales) offre un dossier étoffé consacré au rôle du graveur et à la question du modèle. La trentaine de sigillants du corpus constitué par l’auteur sont des prélats (15 évêques ou archevêques, 7 abbés) et des dignitaires capitulaires (11), qui ont possédé 33 grands sceaux et 19 contre-sceaux pour une période d’une quarantaine d’années (1180-122). La précision de la datation et de la localisation de la source sigillaire permet de cerner la production d’un atelier, ici celui d’un graveur que l’auteur baptise « Maître 1200 ». Il rappelle au passage l’ambigüité du terme « type » en sigillographie, qui désigne aussi bien une catégorie d’images que les différentes matrices successives d’un sigillant. L’auteur distingue le modèle épiscopal, porteur de la crosse, le modèle abbatial, crossé et au livre, et réparti les sceaux de dignitaires entre un modèle au manipule et un modèle au livre. Malgré l’importance et la rapidité de la production, et les ressemblances entre matrices, l’atelier n’a pas recours à la fonte : les sceaux sont gravés en taille directe et adaptés au commanditaire grâce à la légende et au contre-sceau qui offre plus de variété. L’absence d’évolution ou d’originalité s’explique selon Clément Blanc-Riehl par la prégnance de la fonction sur la personnalité du clerc à une époque où la diffusion de l’usage du sceau hors du cercle étroit des prélats conduit à valoriser l’expression de la hiérarchie ecclésiale. Cependant la hiérarchie au sein du groupe canonial est atténuée : les attributs spécifiques à une fonction demeurent, au final, plutôt rares dans la production de cet atelier. L’auteur suggère que la rapide progression des carrières ecclésiastiques atténue l’intérêt porté par les chanoines aux attributs, ce dont on peut discuter. Cet article offre une étude originale sur le caractère sériel de certaines productions sigillaires et apporte un contrepoint intéressant aux discours sur le lien ontologique entre le sigillant et son sceau. On regrette seulement que certaines illustrations, disposées de manière à faciliter les comparaisons, soient trop petites pour une lecture aisée.
Le chapitre d’Ambre Vilain (université de Nantes) s’attache à présenter au contraire la valeur singulière qui était attribuée dans certains cas aux images sigillaires : celles-ci avaient parfois une dimension apotropaïque. L’auteur suggère, dans le cadre d’une enquête qui débute seulement, que certaines matrices, retrouvées enfouies en rase campagne ou au fond de cours d’eau, ont été volontairement abandonnées ainsi. A l’image des enseignes de pèlerinage, il est probable que des sceaux, souvent illustrés de sujets religieux et parfois cancellés, étaient jetés dans les cours d’eau et fontaines dans un geste votif. Par ailleurs, certaines matrices étaient modifiées afin d’être portées en pendentif ou accrochées au mur, comme des images pieuses ou des amulettes protectrices. L’agnus dei est en particulier évoqué. Le choix d’une iconographie religieuse pour un sceau, en plus de dénoter une dévotion personnelle, est une forme d’invocation de la protection divine. L’auteur évoque également les légendes en forme d’invocation religieuse, utilisées depuis les Carolingiens et particulièrement appréciées sur les contre-sceaux à partir du XIIe siècle. Le contre-sceau n’a plus alors de fonction identificatrice mais essentiellement une fonction apotropaïque pour l’acte validé et le sigillant lui-même. L’auteur s’attarde sur le cas des croix, peu représentées comme figure majeure de l’image sigillaire mais omniprésentes en légende sous la forme de la croisette initiale. Enfin elle rappelle que la conception du sceau englobe au Moyen Âge aussi bien sa fonction juridique que sa dimension apotropaïque.
Els De Paermentier (université de Gand) choisit de mettre en perspective les pratiques de scellement de la chancellerie des comtes de Flandre avec l’effort d’organisation de sa production écrite. Après avoir rapidement présenté les sceaux comtaux de Robert Ier le Frison jusqu’à Jeanne de Constantinople (soit de 1071 à 1244), l’auteur brosse un tableau des usages sigillaires de leurs chanceliers, gardes scels et clercs. Les chanceliers jouaient un rôle central dans le système politique flamand, d’où des luttes entre les comtes et le chapitre de Saint-Donatien de Bruges pour contrôler leur nomination. Par le biais d’une règlementation écrite, la comtesse Jeanne parvint à reprendre en main la production scellée de sa chancellerie, notamment en vidant la fonction de chancelier de toute prérogative d’importance et de toute autonomie. Gérard d’Alsace utilisa quatre sceaux à partir de 1187, associés en certaines occasions à des contre-sceaux, d’abord comme prévôt du chapitre de Saint-Omer puis comme chancelier de Flandre. Ses successeurs semblent utiliser un seul sceau. Celui du dernier chancelier, Philippe de Savoie, retenu loin de la cour du fait d’une carrière dynamique, est inconnu. Ces sigillants adoptent le type en pied ou au pupitre pour leur grand sceau, et le lion de Flandre pour leurs contre-sceau, sauf Guillaume de Capella qui retient une image parlante (une chapelle). Les clercs de la chancellerie préfèrent quant à eux des scènes de dévotion ou des motifs floraux. Bien peu ont laissé de sceau ou d’actes portant mention d’un scellement : cinq en l’état actuel des recherches. Alors que les légendes des sceaux des chanceliers font clairement état de leur fonction, celles des sceaux de clercs demeurent muettes sur ce point. L’auteur conclut à l’absence d’esprit de corps dans cette production sigillaire : les efforts d’uniformisation de la production écrite de la chancellerie ne se sont pas accompagnés d’une uniformisation des légendes et images des sceaux de son personnel.
Au travers du grand sceau de la Commune de Douai, appelé le « Martinet », Thomas Brunner (université de Strasbourg) s’interroge sur la fonction d’une image sigillaire à la signification aujourd’hui obscure mais pourtant choisie comme incarnation de l’identité d’une ville. Cette contribution s’ouvre sur une présentation de l’usage de ce sceau de 1181 à 1547, soit un corpus d’une quarantaine d’actes (un tableau récapitulatif se trouve en annexe). Le Martinet se révèle plus ancien que ne l’affirme la littérature à son sujet : utilisé dès 1181, il date probablement de 1165-1177, période de mise en place de la Commune. L’auteur distingue trois périodes dans les usages de ce sceau : avant 1224, il est seul et utilisé pour tout type d’actes, parfois associé à d’autres sigillants de poids (chapitre, agent comtal) ; autour de 1224 la bourgeoisie s’arroge la juridiction gracieuse sous la forme des chirographes échevinaux, ce qui conduit à réduire l’usage du Martinet aux chartes de prestige, notamment les relations de la Commune avec l’extérieur ; enfin, à partir des années 1290, son usage devient codifié, cérémoniel et consacré à la gestion financière de la ville, concurrencé par un sceau aux causes, des contre-sceaux et des sceaux secrets pour les questions judiciaires puis également financières, ce qui conduisit à délaisser le Martinet. L’auteur suggère que l’iconographie de ces sceaux de juridiction – la porte de la cité – était mieux à même d’incarner la Commune que l’image du grand sceau, devenue incompréhensible au fil du temps. Il s’attache dans une deuxième partie à éclairer justement la scène figurant sur le champ de ce sceau. Le cavalier terrassant un dragon en présence de deux personnages en pied fut tour à tour assimilé à saint Martin (d’où le nom du sceau attesté au XIXe siècle et remontant peut-être au XVIe siècle) et à saint Georges. Comparant cette image aux autres productions contemporaines et aux dévotions douaisiennes, ces interprétations sont écartées. Selon l’auteur, ce cavalier sauroctone pourrait renvoyer à un rituel d’exposition d’une figure de dragon lors de certaines cérémonies à Douai ou à la figure du bien combattant le mal, que l’on retrouve sur les sceaux équestres d’officiers anglais, français et flamand à la même époque. En fin de chapitre, un dessin du sceau est accompagné d’une longue et précise description qui est la bienvenue pour comprendre un propos érudit et une analyse prudente.
Jean-Luc Chassel (université Paris X-Nanterre) consacre son étude aux sceaux de femmes de haut rang, les châtelaines de Tournai et de Saint-Omer, aux XIIIe et XIVe siècles. L’auteur s’attache ici à éclairer les choix armoriaux de ces aristocrates à la lumière de leurs origines lignagères et de leur statut d’héritières ou de douairière. Il rappelle dans un premier temps la très lente émergence de l’intérêt porté aux armoiries sigillaires des femmes, longtemps considérées comme une simple reprise des emblèmes maritaux et paternels. Or l’auteur insiste sur l’importance de l’adoption des armoiries d’un époux pour une femme qui doit défendre ses droits sur son douaire en cas de veuvage. Il évoque également la fréquente relégation des armes maritales en seconde position sur le sceau quand la dame apporte un fief dans le mariage. Les sceaux des châtelaines de Tournai et de Saint-Omer sont révélateurs : plusieurs de ces dames favorisent les armoiries de leur famille au détriment de celles de leur époux, placées en seconde position, voire ignorées. Certaines vont jusqu’à faire graver les armes de leur grand-mère, pour soutenir des prétentions à un héritage ou souligner une alliance politique. Le veuvage et la présence d’enfants en bas âge peut expliquer la conservation de matrices de sceau malgré un remariage : la titulature rappelle les droits des douairières et ceux des hoirs dont elles ont la tutelle. Les contre-sceaux participent à ces joutes héraldiques entre époux. Car nombre de maris ignorent de leur côté armoiries et titres d’épouses pourtant héritières. La mention des choix d’armoiries et de titulatures des époux permet de replacer ces sceaux de femmes dans le contexte plus général des alliances matrimoniales et des jeux d’influences entre lignages.
Enfin, Jean-Christophe Blanchard (université de Lorraine) reprend la question des sceaux équestres pour la période de la Renaissance. Dans un premier temps, les sceaux des ducs de Lorraine sont présentés de 1473 à 1608, période où une nouvelle maison, les Vaudémont, s’impose à la tête du duché (une généalogie bienvenue est en annexe). Ces quatre sceaux se caractérisent par leur grande ressemblance. Puis l’auteur analyse les choix sigillaires des ducs qui visent à assoir cette nouvelle dynastie ducale. Dès le sceau de René II, composition et style rattachent les sceaux des Vaudémont aux sceaux du précédent duc, Nicolas d’Anjou, qui s’était lui-même inspiré des sceaux ante susceptum de ses cousins rois de France. Le choix des longues titulatures déroulées en légendes ne doit rien au hasard ou à la répétition, jouant sur les prétentions et les héritages successifs. Il en va de même pour les armoiries et les emblèmes : aigle traditionnel de Lorraine, lys de France, puis croix de Lorraine dont l’apparition marque la progressive affirmation du nouveau lignage qui se dégage de l’influence française, et enfin croix de Jérusalem qui évoque l’ancêtre Godefroid de Bouillon. Le sceau de Charles III, gravé alors qu’il n’avait que 6 ans, ne montre pas la personnalité du sigillant mais manifeste le prestige de la maison de Lorraine. L’auteur replace d’ailleurs ce sceau dans le contexte de la production historiographique des ducs de Lorraine, agrémentée de portraits qui ont pu inspirer le programme iconographique du grand sceau équestre du jeune duc.
Laurent Macé (université de Toulouse) vient conclure cet ouvrage riche et utile. S’il insiste sur l’importance de l’outil informatique, qui facilite grandement le travail du chercheur et sa diffusion, il rappelle l’importance de rester au contact de la source, à savoir le sceau et son acte, riche en informations. L’abondance des fonds en sigillographie demanderait le développement d’études sigillographiques à l’université. Spécialiste du Midi, il apporte quelques comparaisons utiles avec la chronologie des régions septentrionales et s’interroge sur la circulation de modèles, l’importance des filiations matrilinéaires et le rôle de la sigillographie dans les études consacrées à la culture visuelle.
Caroline SIMONET
Revue française d’héraldique et de sigillographie, édition en ligne
© Société française d’héraldique et de sigillographie, 2019
Sommaire
Avant-propos (Marc Libert et Jean-François Nieus)
– Metal Casts of Seals. Some Early Impressions (John Cherry)
– Le corpus des documents mérovingiens et carolingiens des Archives nationales : de l’étude à la valorisation (Marie-Adélaïde Nielen)
– L’atelier des sceaux des archives nationales de France : 150 ans de pratiques et d’échanges avec les services sigillographiques de France et d’Europe (Agnès Prévost)
– La collection de moulages de sceaux médiévaux de l’historien russe Nicolai Likhatchev (1862-1936) : la provenance et l’usage (Ekaterina Nosova)
– Les sceaux des villes du comté de Flandre au Moyen Âge : la réalisation et l’utilité d’un nouveau répertoire illustré (Thérèse de Hemptinne, Lieve De Mey)
– La numérisation en 3D de la collection de matrices de sceaux des Archives générales du Royaume (Marc Libert)
– Le programme “SIGILLA”, base de donnée nationale des sceaux des archives françaises (Laurent Hablot)
– L’introduction du sceau équestre dans l’Empire (Jean-François Nieus)
– L’aristocratie cambrésienne et ses sceaux. Appropriation et diffusion de la pratique sigillaire entre France et Empire, milieu XIIe-début XIIIe siècle (Nicolas Ruffini-Ronzani)
– L’emprunt de sceau, Nord de la France, XIIe et XIIIe siècles (Benoît-Michel Tock)
– Un graveur de sceaux des années 1200 : entre type et modèles (Clément Blanc-Riehl)
– AGNVS DEI MISERERE NOBIS : le sceau médiéval comme support de la protection privée (Ambre Vilain)
– Pratiques de scellement et identité administrative à la chancellerie comtale en Flandre et en Hainaut, fin XIIe-première moitié XIIIe siècle (Els De Paermentier)
– Le “Martinet”, grand sceau de la commune de Douai (fin XIIe-XVe siècle). Recherches sur le sens perdu d’un sceau (Thomas Brunner)
– Femmes, armoiries et lignage. Les sceaux des châtelaines de Saint-Omer et de Tournai, XIIIe-XIVe siècles (Jean-Luc Chassel)
– Innover dans le respect de la tradition : Les sceaux équestres des ducs de Lorraine de René II à Charles III, 1473-1608 (Jean-Christophe Blanchard)
Conclusions. Du reflet spéculaire à l’œuvre visuelle : le sceau et l’historien (Laurent Macé)